Les erreurs fréquentes de la concordance des temps et comment les éviter
La conjugaison des verbes selon la concordance des temps est un enjeu majeur en grammaire française. Maîtriser cet accord garantit non seulement la cohérence temporelle d’un texte, mais aussi la clarté et la précision du propos. Pourtant, il reste fréquent de rencontrer des erreurs d’accord des temps verbaux, notamment chez les apprenants ou même dans certains écrits professionnels. Ces erreurs peuvent altérer la compréhension ou nuire au style, voire déstabiliser le lecteur. Afin d’éviter ces pièges, il convient d’explorer les principes fondamentaux de la concordance des temps, d’identifier les erreurs les plus courantes et de proposer des solutions adaptées. Dans cet article, nous détaillons les règles grammaticales en vigueur, fournissons des exemples concrets issus de situations réelles, et mettons en lumière les techniques pour éviter les fautes les plus fréquentes.
les fondements essentiels de la concordance des temps en grammaire française
La concordance des temps constitue le lien harmonieux entre le temps du verbe principal et celui de la ou des propositions subordonnées. En français, c’est une règle qui vise à assurer la cohérence temporelle à l’intérieur d’une phrase complexe ou d’un récit. Cette notion est fondamentale pour toute personne qui souhaite produire un texte clair, fluide et grammaticalement correct.
Concrètement, dans une phrase comme « Le directeur annonce que le poste sera supprimé », le verbe principal « annonce » au présent est suivi d’une subordonnée au futur simple « sera supprimé ». Cette association est correcte car le futur exprime une action qui est postérieure au moment où la déclaration est faite. Mais si la phrase était « Le directeur a annoncé que le poste sera supprimé », le maintien du futur simple peut engendrer un doute sur la temporalité parce que l’annonce est passée ; la subordonnée devrait alors privilégier un temps en accord avec le passé, comme le conditionnel passé « serait supprimé ».
Différents temps s’emploient selon la nature de l’action (antériorité, simultanéité, postériorité) et la position temporelle du verbe principal. Les temps du passé comprennent notamment l’imparfait, le passé simple, le passé composé et le plus-que-parfait. Le futur simple s’emploie pour évoquer une action qui se déroulera après le moment exprimé par la principale. L’imparfait signale souvent une action prolongée ou habituelle dans le passé.
Une erreur classique se manifeste lorsque l’on conserve un temps verbal inadapté par exemple un présent ou un passé composé dans une subordonnée alors que la principale est au passé : « Il pensait qu’elle a oublié » au lieu de « Il pensait qu’elle avait oublié ». Cette confusion provient souvent d’une méconnaissance des règles de l’accord des temps. Le tableau suivant présente les correspondances types entre temps de la principale et temps de la subordonnée selon la nature de la relation temporelle.
| Temps de la proposition principale | Antériorité dans la subordonnée | Simultanéité dans la subordonnée | Postériorité dans la subordonnée |
|---|---|---|---|
| Présent | Passé composé, passé simple | Présent | Futur simple |
| Passé simple / imparfait | Plus-que-parfait | Imparfait, passé simple | Conditionnel présent |
| Futur simple | Passé composé | Présent, futur simple | Futur antérieur |
- Antériorité : l’action de la subordonnée s’est déroulée avant celle de la principale.
- Simultanéité : les actions ont lieu en même temps.
- Postériorité : l’action de la subordonnée se produira après celle de la principale.
Ces règles s’appliquent strictement dans la majorité des constructions, en particulier dans les textes formels, dans les écrits académiques ou professionnels. Pour approfondir la maîtrise des temps verbaux en contexte, la ressource suivante propose des pistes précisées sur l’usage particulier de l’imparfait du subjonctif qui peut s’avérer utile pour saisir les nuances des temps dans des constructions complexes.

les erreurs fréquentes dans la concordance des temps et leurs origines
Parmi les erreurs récurrentes observées en concordance des temps, plusieurs se démarquent par leur impact négatif sur la cohérence d’un texte :
- Usage incorrect du futur simple après un verbe au passé : comme dans « Il disait qu’il partira » au lieu de « Il disait qu’il partirait ».
- Mauvais emploi du passé composé en subordonnée alors que le plus-que-parfait est requis : « Elle pensait qu’il a oublié » au lieu de « Elle pensait qu’il avait oublié ».
- Confusion entre temps du passé et temps du présent dans un même récit : mélange inapproprié ne justifiant pas un effet stylistique.
- Alternance non contrôlée du mode indicatif et subjonctif : recours inapproprié notamment dans des propositions dépendantes exprimant doute ou incertitude.
Ces erreurs, souvent observées dans les écrits d’étudiants ou de professionnels peu familiarisés avec les subtilités des règles grammaticales, proviennent généralement d’un choix non réfléchi du temps principal du récit, d’une mauvaise identification de la relation temporelle entre les actions ou d’une influence de la langue orale.
Les cas rencontrés dans la presse ou la littérature illustrent bien cette problématique. Par exemple, certains articles récents affichent des incohérences en alternant des temps sans transition claire : « La ministre a déclaré qu’elle sera présente demain, bien qu’elle ait eu plusieurs rendez-vous aujourd’hui ». Cette phrase perd en rigueur car le futur simple « sera présente » suit un verbe au passé composé « a déclaré » sans modifier le temps en conditionnel ou futur antérieur.
Pour prévenir ces écueils, une méthode efficace consiste à notifier explicitement la chronologie prévue avant la rédaction et à vérifier systématiquement l’accord des temps entre la principale et la subordonnée. On peut aussi se référer à des outils reconnus en grammaire française pour détecter les dissonances temporelles avant publication.
| Erreur courante | Exemple erroné | Correction conforme | Cause principale |
|---|---|---|---|
| Futur simple après un passé | Il disait qu’il partira. | Il disait qu’il partirait. | Mauvais choix de temps par manque d’analyse. |
| Passé composé au lieu du plus-que-parfait | Elle pensait qu’il a oublié. | Elle pensait qu’il avait oublié. | Confusion temporelle entre passé récent et antérieur. |
| Mélange incohérent des temps | Je suis sûr que j’avais raison. | Je suis sûr que j’ai raison. | Mauvaise vérification de la temporalité. |
| Alternance subjonctif/indicatif | Il faut qu’il est à l’heure. | Il faut qu’il soit à l’heure. | Méconnaissance du mode requis. |
- Préférer la cohérence temporelle en planifiant la narration.
- Utiliser des aides à la rédaction numériques pour repérer les erreurs.
- Relire attentivement pour corriger les glissements non intentionnels.
- Se former ou se renseigner régulièrement sur les règles évolutives de la grammaire française.
L’art subtil des variations et répétitions verbales est aussi étendu dans la langue française, comme détaillé dans le guide sur l’art du polyptote, un procédé linguistique qui peut aider à maîtriser les nuances d’accord tout en enrichissant le style.
l’accord des temps entre propositions principales et subordonnées : règles et exemples pratiques
La grammaire française impose une logique temporelle stricte dans les enchaînements de propositions. La concordance des temps exige que le temps de la proposition principale influe directement sur celui employé dans la subordonnée de temps, de cause, de conséquence ou de condition. Respecter cette harmonisation assure la cohérence globale du texte.
Pour illustration, prenons la phrase complexe suivante : « Lorsque le professeur expliquait, les élèves prenaient des notes ». Ici, les deux verbes sont à l’imparfait, traduisant une action répétée ou simultanée dans le passé. De manière analogue, « Il avait fini son devoir avant que le cours ne commence » conjugue au plus-que-parfait la principale pour marquer une antériorité passée par rapport au présent de la subordonnée.
Les erreurs apparaissent quand on ne respecte pas ces correspondances, par exemple : « Il avait fini son devoir avant que le cours a commencé », où le présent ou passé composé mal placé révèlent un défaut d’accord. Dans certains contextes, l’emploi du subjonctif modifie l’accord des temps, notamment dans les subordonnées exprimant doute, volonté, ou nécessité. Le tableau ci-dessous récapitule les principales règles d’accord en fonction du temps et du mode.
| Temps principal | Temps subordonné (indicatif) | Temps subordonné (subjonctif) |
|---|---|---|
| Présent | Présent | Présent |
| Passé composé | Passé composé ou imparfait | Passé ou imparfait |
| Imparfait | Imparfait ou plus-que-parfait | Imparfait ou plus-que-parfait (rare) |
| Passé simple | Passé simple ou plus-que-parfait | Passé ou plus-que-parfait |
| Futur simple | Présent ou futur simple | Présent ou futur simple |
- Éviter les discordances comme le mélange de passé simple avec présent dans la subordonnée.
- Vérifier la cohérence du mode avec les verbes exprimant doute (subjonctif) ou certitude (indicatif).
- Utiliser l’imparfait et le plus-que-parfait pour exprimer l’antériorité.
- Pratiquer des exercices réguliers pour automatiser la concordance.
Le recours au présent dans des contextes passés, appelé le présent historique, mérite une attention particulière car il crée un effet de vivacité mais doit rester ponctuel pour ne pas dérouter. Ce point est approfondi dans les articles référencés pour éviter toute maladresse lors de la rédaction.
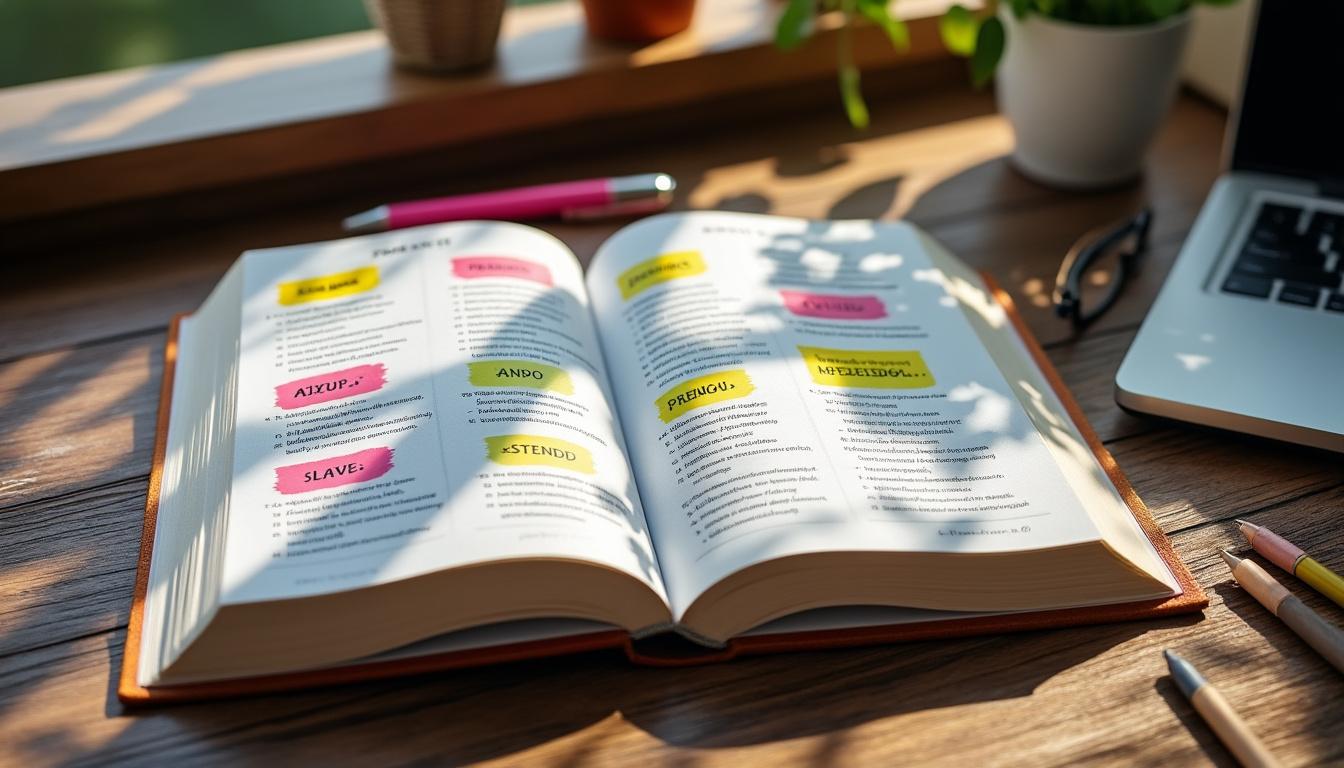
comment éviter les erreurs courantes d’accord des temps dans les écrits professionnels
Sur le plan professionnel, que ce soit dans la rédaction de rapports, de synthèses ou de communications internes, l’exactitude dans l’accord des temps verbaux est un gage de sérieux et de compétence. Plusieurs leviers permettent d’éviter les erreurs fréquentes et d’assurer une grammaire impeccable :
- Adopter un temps narratif unique : choisir strictement entre passé et présent selon la nature du texte pour limiter les risques de glissement.
- Relire en ciblant les accords temporels : identifier les subordonnées et vérifier systématiquement les temps utilisés.
- Recourir à des logiciels ou correcteurs grammaticaux : intégrant des règles sur la concordance des temps pour détecter automatiquement les incohérences.
- Se former continuellement : les règles de grammaire française évoluent et se complexifient, suivre des formations reste indispensable.
- Employer des outils pédagogiques : comme des tableaux de conjugaison ou des fiches pratiques.
L’exemple ci-dessous illustre une correction utile d’une phrase trop souvent mal construite : « Le chef de projet a indiqué que l’équipe terminera le dossier demain », corrigée en « Le chef de projet a indiqué que l’équipe terminerait le dossier demain » pour respecter l’accord du futur dans la subordonnée par rapport au passé de la principale.
| Phrase erronée | Phrase corrigée | Pourquoi ? |
|---|---|---|
| Le chef de projet a indiqué que l’équipe terminera le dossier demain. | Le chef de projet a indiqué que l’équipe terminerait le dossier demain. | Concordance du futur dans la subordonnée avec le passé composé de la principale. |
| Le directeur a précisé qu’il avait validé le contrat la semaine prochaine. | Le directeur a précisé qu’il validerait le contrat la semaine prochaine. | Correction du temps exprimant une action future relative au moment passé. |
Ce travail rigoureux dans la rédaction professionnelle influence directement la crédibilité des documents et évite les ambiguïtés lors de lectures critiques. En outre, il facilite la communication entre collaborateurs et partenaires.
les subtilités d’emploi des temps verbaux dans les récits et la narration
Dans la narration, le respect strict de la concordance des temps peut parfois céder la place à des choix stylistiques. En effet, l’alternance contrôlée des temps participe à la dynamique du récit, notamment dans les romans ou récits à la première personne. Cette stratégie vise à immerger le lecteur, à accentuer l’intensité des scènes.
Le présent de narration, utilisé pour décrire des événements passés, confère un effet d’immédiateté. Par exemple, des auteurs contemporains alternent passé simple et présent dans un même paragraphe pour marquer une transition émotionnelle ou mettre en relief un souvenir ressenti avec intensité. La cohérence demeure dans la progression temporelle générale, mais le changement de temps ponctuel est justifié.
- Usage du présent pour renforcer la tension dramatique.
- Passage à l’imparfait pour établir le contexte ou l’arrière-plan.
- Retour au passé simple pour la narration principale des faits.
- Alternance qui traduit une perception subjective ou un moment de contemplation.
Cette pluralité d’usages impose de bien comprendre les règles fondamentales avant de s’autoriser ces écarts. Un exemple emblématique en littérature est celui de Patrick Modiano, qui exploite l’alternance des temps pour évoquer le trouble identitaire et le caractère fragmenté de la mémoire. À l’inverse, un usage inadéquat peut entrainer un texte confus et rendre difficile la lecture.
| Usage narratif | Temps privilégié | Effet recherché |
|---|---|---|
| Contexte ou description | Imparfait | Installer un cadre temporel stable |
| Action principale | Passé simple | Raconter une suite d’événements |
| Moment d’immédiateté | Présent de narration | Créer la vivacité et l’immersion |
| Réflexion ou souvenir | Plus-que-parfait | Marquer l’antériorité dans le passé |
Des ouvrages didactiques comme ceux proposés par des éditeurs reconnus sont disponibles pour s’exercer et se perfectionner sur ces points spécifiques. La recommandation est d’utiliser la concordance des temps comme fondement solide avant de s’autoriser des variations stylistiques.
l’impact des erreurs de concordance des temps dans les communications familiales et éducatives
La maîtrise des temps verbaux ne concerne pas uniquement les écrits professionnels ou littéraires. Dans le cadre familial et éducatif, une bonne concordance des temps facilite la transmission claire des idées, des consignes ou des récits entre parents, enfants et enseignants. Par exemple, dans la rédaction d’un rapport d’activité scolaire ou d’un compte rendu de réunion parent-professeur, les erreurs d’accord peuvent brouiller le sens, voire modifier la portée d’une information.
Les enfants en apprentissage bénéficient d’un enseignement rigoureux pour éviter de prendre de mauvaises habitudes grammaticales. Les enseignants des cycles élémentaires recommandent fréquemment d’utiliser des phrases simples privilégiant l’imparfait et le passé composé, avant de complexifier avec les temps composés et les règles de concordance.
- Donner des exemples concrets pour illustrer la chronologie des événements.
- Privilégier la répétition de structures justes pour ancrer les bonnes pratiques.
- Utiliser des exercices ciblés pour travailler la concordance en contexte.
- Impliquer les parents dans l’apprentissage pour renforcer la cohérence grammaticale à la maison.
Cette rigueur trouve son illustration dans des ressources pédagogiques disponibles en ligne ou dans les manuels scolaires, qui insistent sur l’accord des temps comme levier de compréhension. Par ailleurs, la concordance est un critère évalué dans les examens officiels dès le primaire, ce qui justifie un apprentissage précoce et structuré.
| Âge ou niveau | Temps privilégiés | Objectifs pédagogiques |
|---|---|---|
| Cycle 2 (6-8 ans) | Présent, passé composé | Connaître et utiliser les temps fondamentaux |
| Cycle 3 (9-11 ans) | Imparfait, plus-que-parfait | Comprendre la chronologie et maîtriser la concordance |
| Collège | Passé simple, subjonctif | Développer la narration complexe |
Ces étapes pédagogiques recommandées permettent d’éviter les erreurs les plus fréquentes de la concordance des temps par une progression adaptée. L’engagement des parents dans ce processus est d’autant plus bénéfique que la répétition et la régularité sont garantes de la bonne acquisition.
l’usage et les limites du présent de narration dans la concordance des temps
Le présent de narration est un phénomène spécifique de la langue française consistant à utiliser le présent pour narrer des faits passés, afin de renforcer l’impact et l’immédiateté du récit. Son emploi, courant dans la littérature, le journalisme ou dans les récits oraux, apporte une dynamique et un réalisme au texte.
Par exemple, dans un reportage décrivant une bataille historique, on peut lire : « Napoléon débarque à Golfe-Juan. Il marche vers Paris et entre dans la capitale sous les acclamations. » Ici, l’usage du présent donne l’impression que l’événement se déroule en temps réel, bien qu’il soit ancien.
Ce procédé a ses règles et limites :
- Il doit être employé de façon ponctuelle et cohérente dans un passage pour ne pas désorienter le lecteur.
- L’alternance avec des temps du passé est fréquente pour insérer contexte et conséquences.
- Il n’est pas compatible avec toutes les structures grammaticales : attention aux subordonnées dont le temps doit respecter la concordance.
- L’usage abusif peut nuire à la clarté et rendre le récit confus.
On distingue le présent historique, présent de vérité générale ou présent de description, mais c’est surtout le présent historique qui entre en relation directe avec la concordance des temps. Pour une maîtrise approfondie et des exemples précis, la consultation de manuels spécialisés reste conseillée.
| Type de présent | Usage | Exemple |
|---|---|---|
| Présent historique | Raconter un fait passé avec vivacité | Le général charge, la bataille fait rage. |
| Présent de vérité générale | Exprimer un fait toujours vrai | L’eau bout à 100 degrés Celsius. |
| Présent de description | Décrire une scène ou un état | Le ciel est couvert et la mer agitée. |
L’usage réfléchi du présent de narration fait partie des stratégies avancées pour éviter les erreurs de concordance, en particulier dans la rédaction d’œuvres littéraires ou journalistiques.
techniques et conseils pratiques pour maîtriser la concordance des temps en écriture
Pour progresser efficacement dans l’accord des temps verbaux, plusieurs techniques peuvent être adoptées. Il s’agit de construire une méthodologie rigoureuse qui évite les erreurs fréquentes et renforce la qualité rédactionnelle.
- Identifier clairement le temps principal du récit avant d’écrire.
- Rédiger d’abord les propositions principales, puis intégrer les subordonnées avec une attention particulière à leur temps.
- Relire à voix haute pour détecter des incohérences temporelles ou stylistiques.
- Utiliser des exercices ciblés comme la conjugaison dans différents contextes.
- Faire appel à des outils numériques ou correcteurs pour la vérification finale.
Il est également judicieux d’apprendre à différencier les nuances entre l’imparfait et le passé composé, ou encore le futur simple et le conditionnel, car ce sont souvent ces distinctions qui posent problème. La lecture régulière d’ouvrages bien écrits contribue à intégrer naturellement ces règles. Pour aller plus loin, des articles pédagogiques spécialisés offrent des approfondissements et illustrations variées.
| Action | Temps à privilégier | Erreur fréquente à éviter |
|---|---|---|
| Action répétée dans le passé | Imparfait | Passé composé |
| Action ponctuelle et achevée | Passé composé ou passé simple | Mélanger imparfait et passé simple sans logique |
| Action future certaine | Futur simple | Utiliser le présent sans repère temporel clair |
De manière complémentaire, l’étude du subjonctif, ainsi que la maîtrise de ses formes comme l’imparfait du subjonctif, contribuent à éviter des erreurs d’accord liées au mode. Un cours dédié sur l’imparfait du subjonctif offre des clés pour comprendre ce mode complexe.
le rôle de la concordance des temps dans l’amélioration de la clarté et la qualité rédactionnelle
Le respect des règles de concordance des temps est un facteur déterminant pour garantir la clarté d’un texte, son rythme et son style. Cette harmonie temporaire facilite la compréhension pour le lecteur et assure une progression logique des idées.
Une phrase où les temps sont en accord produit un effet de cohérence, tandis qu’une discordance génère une suspension dans la narration ou un flottement conceptuel. Par exemple, dans un manuel scolaire décrivant un processus, l’utilisation correcte des temps verbaux permet au lecteur de suivre l’enchaînement des étapes sans confusions.
- Améliore la lisibilité des écrits.
- Permet une meilleure structuration du texte.
- Valorise le style et le professionnalisme de l’auteur.
- Réduit les risques d’erreurs d’interprétation.
En contexte professionnel, on remarque aussi que la maîtrise de ces règles participe à une communication plus efficace entre collègues, favorise la précision des rapports et facilite les échanges écrits avec les clients ou partenaires. Certaines grandes maisons d’édition, comme Gallimard ou Hachette, insistent sur ces normes dans les ouvrages pédagogiques et les guides d’écriture publiés.
| Aspect amélioré | Conséquence positive | Exemple |
|---|---|---|
| Clarté | Lecture fluide et compréhension rapide | Un texte où les temps sont rigoureusement accordés |
| Style | Expression élégante et cohérente | Usage contrôlé des temps pour renforcer le message |
| Professionnalisme | Crédibilité accrue de l’écrit | Rapports d’entreprise sans fautes d’accord |
| Compréhension | Moins d’ambiguïtés et d’erreurs d’interprétation | Consignes claires dans les communications |
la place des nouvelles technologies dans la correction des erreurs de concordance des temps
Avec l’avènement des outils numériques, la relecture et la correction des textes ont gagné en efficacité. Plusieurs logiciels et applications françaises ou internationales se spécialisent dans l’analyse grammaticale, détectant notamment les incohérences de temps verbaux. Cela facilite grandement l’apprentissage et la correction rapide des erreurs fréquentes.
Parmi les outils très utilisés figurent Antidote, Grammarly (adapté au français), ainsi que des plateformes éducatives intégrant des modules d’entraînement. Ces solutions s’appuient sur des bases de données grammaticales exhaustives et offrent parfois des propositions alternatives pour améliorer la concordance des temps.
- Détection automatique des erreurs d’accord des temps.
- Suggestions adaptées au contexte du texte.
- Exercices interactifs pour renforcer les compétences.
- Personnalisation selon le niveau de compétence.
Cependant, l’appui humain reste indispensable pour juger de la pertinence stylistique des choix narratifs. Le recours aux outils numériques est une aide précieuse mais ne remplace pas la compréhension des règles grammaticales.
| Outil numérique | Fonctionnalité principale | Avantage | Limite |
|---|---|---|---|
| Antidote | Correction grammaticale et suggestions stylistiques | Riche base de règles françaises | Pas toujours adapté aux cas littéraires complexes |
| Grammarly (français) | Détection des fautes et correction | Interface conviviale et rapide | Moins précis sur certains accords subtils |
| Plateformes d’e-learning | Exercices et tutoriels ciblés | Apprentissage progressif et interactif | Nécessite une discipline personnelle |
Qu’est-ce que la concordance des temps ?
La concordance des temps est la règle grammaticale qui impose l’accord des temps verbaux entre une proposition principale et ses subordonnées afin d’assurer la cohérence temporelle et la clarté du discours.
Quels sont les temps verbaux les plus impliqués dans les erreurs fréquentes ?
Les temps les plus concernés par les erreurs sont le passé composé, l’imparfait, le futur simple et le plus-que-parfait, notamment lors de leur association dans des phrases complexes.
Comment éviter de mélanger les temps involontairement ?
Il est conseillé de choisir un temps narratif principal pour le texte et de vérifier chaque phrase pour s’assurer que les temps des subordonnées sont compatibles, en s’aidant d’outils numériques ou de fiches pédagogiques.
Peut-on alterner entre présent et passé dans un récit ?
Oui, mais uniquement lorsqu’il s’agit d’un choix stylistique justifié, comme le présent de narration, qui vise à créer un effet d’immédiateté ou de tension, sans nuire à la compréhension.
Quels outils utiliser pour vérifier la concordance des temps ?
Des logiciels comme Antidote ou Grammarly, ainsi que des plateformes pédagogiques avec des exercices ciblés, permettent de détecter et corriger les erreurs courantes, complétés par une bonne connaissance des règles grammaticales.



